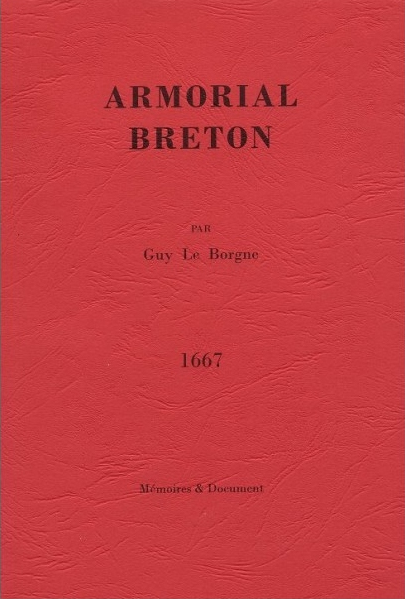1 – Définitions des titres
– BARON : Un baron était à l’origine l’homme du roi. Cette qualification s’appliqua d’abord aux grands vassaux du roi, mais peu à peu ce titre perdit de son importance ; à partir du XVIe siècle, le baron ne fut plus que le seigneur d’une baronnie, terre groupant plusieurs fiefs. L’érection de simples seigneuries devint fréquent à partir du XVIe siècle, comme nous allons le voir.
– VICOMTE : Un vicomte était sous les carolingiens le remplaçant du comte (vice-comes). Lorsque les fiefs devinrent héréditaires, les vicomtes se constituèrent dans les territoires dont ils avaient la charge avec les comtes, de véritables fiefs qui reçurent le nom de vicomté.
– COMTE : Un comte fut tout d’abord le dignitaire chargé de l’administration d’une province. Devenu, au moyen âge, suzerain de cette province, le comte y posséda dès lors des droits régaliens (haute justice, droit de battre monnaie, droit de guerre, voire d’anoblir). La royauté, par la suite, érigea en faveur de sa noblesse des terres en comtés. Mais alors que les anciens comtés, comme ceux de Toulouse, Champagne, Valois avaient la taille d’un ou deux départements actuels, les nouveaux comtés n’englobaient plus que quelques paroisses.
– MARQUIS : Un marquis était à l’origine un chef militaire chargé de la défense et de l’administration d’une province frontière (marche). Cette situation géographique stratégique et périlleuse donnait à cette époque aux marquis une sorte de prépondérance sur les comtes. Cette prépondérance perdura jusqu’à nous dans la hiérarchie des titres nobiliaires.
– PRINCE : Ce titre qui nous est venu d’Italie (principe) désignait en ce qui concerne cet ouvrage le titulaire d’une principauté.
2 – Les Titres Réguliers
Tout d’abord rappelons que le fondement de la noblesse titrée était la propriété de terres dont les revenus permettaient de tenir le rang correspondant au titre accordé par le souverain, d’où une hiérarchie des titres de noblesse. En effet on trouve souvent dans les lettres patentes d’érection d’un fief de dignité la mention du revenu des terres qui la composeront. Le revenu était un des critères principaux retenu par le roi pour décider du rang qu’allait occuper la future terre titrée dans la hiérarchie des titres. On retrouvera ces critères de rang et de revenu avec les majorats de l’Empire et de la Restauration.
La hiérarchie était celle-là : Elle commençait par le moins élevé des titres, la châtellenie, qui n’est pas traitée dans cet ouvrage. Puis viennent dans l’ordre croissant de dignité : baronnie, vicomté, comté, marquisat, principauté ; quant au duché et au duché-pairie ils tenaient une place bien à part parmi les terres titrées, ils ont déjà été étudiés par d’excellents confrères. Reste le titre de vidamie qui avait une origine essentiellement religieuse.
Seul un édit de 1579 fixe quelque peu cette hiérarchie, en stipulant que :
-La baronnie sera composée de trois châtellenies au moins
-Le comté aura deux baronnies et trois châtellenies au moins, ou une baronnie et six châtellenies.
-Le marquisat sera composé de trois baronnies et de trois châtellenies au moins ou de deux baronnies et de six châtellenies
L’esprit de ce texte, c’est à dire la hiérarchie des titres, perdura. Quant à la lettre, elle ne fut presque jamais observée, comme nous le verrons plus loin.
Rappelons qu’il n’y avait au royaume de France sous l’Ancien Régime qu’un seul réel moyen légal d’acquérir un titre nobiliaire héréditaire : c’était d’en obtenir la concession par lettres patentes portant érection d’une terre et qu’il était indispensable de faire vérifier et enregistrer au parlement et à la chambre des comptes. Ces formalités indispensables accomplies, le titre passait de mâle en mâle en ligne directe et par ordre de primogéniture sans donner aucun droit aux branches collatérales du premier titulaire. Les fils aînés, du vivant de leur père, n’avaient eux-mêmes aucun titre, et les cadets n’avaient qu’un droit d’expectative en cas d’extinction de la branche de leurs aînés. Suivant un édit du mois de juillet 1556, confirmé par l’ordonnance de Blois, et par une déclaration du roi de 1582, l’érection d’une terre titrée, devait être faite sous la condition expresse, qu’elle serait réunie au domaine de la couronne à défaut d’héritiers mâles directs, nés en légitime mariage. Mais on avait coutume sous l’Ancien Régime de déroger à cette disposition très rigoureuse dans les lettres patentes d’érection. Dans le cas où le possesseur aliénait la terre érigée en marquisat, comté, etc. ; ni lui ni sa famille ne conservaient le moindre droit au titre, mais l’acquéreur pouvait tenter d’obtenir une érection nouvelle pour son fief nouvellement acquis.
Signalons tout de même que l’on pouvait être roturier, et propriétaire d’une terre titrées comme de n’importe quelle seigneurie, à condition de payer le droit de franc-fief ; et dans le cas précis d’une érection en faveur d’un roturier, les lettres patentes anoblissaient en même temps le récipiendaire.
Nombre de familles nobles, si on les interroge sur l’origine de leur titre nobiliaire, prétendent qu’elles ont perdu leurs lettres patentes d’érection de terre. Cette réponse n’a rien de sérieux. En effet, en l’absence des lettres patentes originales on peut retrouver les traces de leur enregistrement au parlement ou à la chambre des comptes ; leur mention et leur rappel dans les jugements de maintenue de noblesse, dans les preuves de noblesse, dans des actes ou des recueils nobiliaires ultérieurs. Il est dont assez facile, pour peu que l’on s’en donne le temps, de vérifier si la possession d’un titre était régulière et légale avant 1789.
Les concessions régulières de titres de noblesse furent d’abord assez peu nombreuses. Mais dès la fin du XVIe siècle, l’on vit apparaître une foule d’usurpations de titres, qui reposaient sur des motifs plus ou moins plausibles. En vain un arrêt rendu au parlement de Paris le 12 août 1663 prononça : » quinze cents livres d’amende contre tous les propriétaires de terres qui se qualifieraient barons, comtes, marquis, etc. ; et qui s’en mettraient les couronnes sur leur écu, sinon en vertu de lettres patentes « . On recula devant l’application stricte de cette mesure, et le mal alla toujours empirant. Le seul contrôle et la seule répression en la matière, c’était le refus que les parlements ou les chambres des comptes faisaient de donner à une personne, dans les actes officiels les titres qu’elle avait usurpés. Dans le cas des chambres des comptes nous avons eu l’occasion de vérifier lors de nos recherches que celle de Dole était très tatillonne concernant notamment les qualificatifs nobiliaires, et surtout les titres.
Au début du règne de Louis XIV, le moindre gentilhomme crut suppléer au défaut de mérite personnel en s’appropriant des qualifications honorifiques. La tolérance la plus complète et l’inexécution de l’arrêt du 12 août 1663 encouragèrent les usurpateurs. La consécration des temps sembla les justifier, et en 1789 on peut estimer qu’il y avait assez peu de titres nobiliaires qui remontât à l’unique source légale, à la concession par lettres patentes d’érection de terre. La règle était donc devenue l’exception.
3 – Les Titres Irréguliers
On peut ranger les titres irréguliers ou usurpés sous l’Ancien Régime en diverses catégories d’après leur origine :
A – Les titres qui reposaient sur des érections de terres dont les lettres patentes n’avaient pas été vérifiées et enregistrées au parlement ou à la chambre des comptes avec la formalité et dans les délais voulus. Dans ce cas, les lettres patentes, à moins qu’elles ne fussent relevées de leur surannation, devenaient de simples brevets de titre personnel et non transmissibles à la postérité du bénéficiaire. Malgré cela, les enfants et descendants du concessionnaire prenaient très souvent, à la mort de ce dernier, le titre non héréditaires dont il était revêtu, et le transmettaient eux-mêmes irrégulièrement à leur postérité.
B – Les titres qui avaient été conférés par des souverains étrangers, et qui reposaient sur des terres sises dans des pays réunis postérieurement à la France, tels que la Franche-Comté, La Lorraine, La Flandre, l’Artois, etc. Pour rester légitime possesseur de ces titres, il fallait en demander la confirmation au roi de France, et payer des droits de finances et d’enregistrement. C’est ce que régla une déclaration du roi du 8 décembre 1699 spéciale pour le Hainaut, la Flandre et l’Artois, dans laquelle on remarquait cette disposition : » Tout noble qui prendra la qualité de baron, comte, marquis etc. ; sans avoir des terres titrées doit être condamné à 50 florins d’amendes. « . Quant aux titres octroyés par les souverains pontifes dans le Comtat Venaissin, ils ne sont théoriquement pas légaux en France, bien que traités dans cet ouvrage, ce territoire n’ayant été annexé à la France qu’après l’abolition des titres féodaux.
C – Les titres conférés par des souverains étrangers et assis sur l’érection d’un fief situé hors de France. De semblables collations de titres avaient besoin d’une confirmation ou plutôt d’une concession nouvelle avec érection de terre en France.
D – Les titres pour lesquels on invoquait la possession centenaire. Cette manière d’acquérir un titre était essentiellement irrégulière. L’arrêt du 12 août 1663 et la déclaration du roi du 8 décembre 1699 ne prévoyaient même pas ce cas exceptionnel. Des déductions lui avaient donné toute sa valeur, en effet une possession centenaire suffisait pour prescrire la noblesse ; elle devait, à plus forte raison suffire pour prescrire les titres. D’ailleurs, si un parlement, en se fondant sur l’arrêt de 1699, eût put refuser dans des actes de sa juridiction, de donner à une personne les titres dont elle se prévalait et ce sans lettres patentes, il n’aurait pas néanmoins pu la poursuivre et lui appliquer l’amende pour usurpation de titre, car la possession centenaire mettait à l’abri de toute peine ou amende. Un tel raisonnement pêche à la base. » Possesseur de mauvaise foi ne peut prescrire « , nous disent le droit écrit et les coutumes médiévaux. Or comment pouvait-on être de bonne foi quand on avait usurpé un titre sans obtention de lettres patentes ? Comment, en outre, invoquer l’USUCAPION, qui ne pouvait s’appliquer qu’à la possession continue et ininterrompue d’une chose, condition qui n’existe pas dans le port d’un titre ? Enfin, est-il bien vrai que la possession centenaire prescrivait réellement la noblesse, ou, en d’autres termes, anoblissait ? Nullement. Elle dispensait seulement d’apporter les preuves plus anciennes qu’un siècle, parce que la noblesse pouvait prendre naissance à diverses sources et son origine étant d’autant plus incertaine qu’elle était plus ancienne, il eut été trop rigoureux d’exiger des preuves remontant au-delà de 100 ans. Mais il n’en était pas de même pour les titres, qui ne pouvaient être portés qu’en vertu de lettres patentes d’érection vérifiées et enregistrées. Les plus anciens titres, sauf ceux de quelques grands feudataires ne remontaient qu’au XVIe s. , et en supposant que les lettres patentes, les registres du parlement et ceux de la chambre des comptes eussent été perdus, on aurait du se pourvoir auprès du roi en délivrance de nouvelles lettres de confirmation. Le vrai motif pour lequel la possession centenaire suffisait, c’est que les usurpations de titres n’ayant jamais été poursuivies, même quand elles étaient très récentes, il eut été singulier et pour ne pas dire anormal de se montrer rigoureux pour celles qui remontaient à plus d’un siècle.
E – Les titres que le roi avait donnés à quelqu’un, sciemment ou par mégarde, dans une lettre autographe qu’il lui adressait. Il ne suffisait pas que la lettre fut signée de Sa Majesté, il fallait en outre qu’elle fut écrite toute entière de sa main. La personne qui recevait une pareille lettre s’empressait généralement de la faire enregistrer au parlement, pour que cette cour de justice ne pût lui opposer plus tard un refus de reconnaissance, seule répression possible. On se fondait sur le vieil adage : » Le roi ne se trompe jamais « . Ce que l’on avait pour le cas d’une lettre autographe a même été étendu aux brevets, aux lettres signées du roi, voire aux écrits de souverains étrangers ou de prince du sang de France, et même quelques fois de ministres ; mais seule la lettre autographe royale avait valeur légale, seulement pour son destinataire, et non pour ses descendants.
F – Les titres insérés dans un contrat de mariage auquel le roi de France avait daigné apposer sa signature. Il semblait en dans ce cas, difficile de poursuivre et de condamner les usurpateurs du titre qui aurait reçu du roi cette espèce de reconnaissance. Mais en résumé tous ces titres n’étaient que des titres de courtoisie.
G – Les titres qui provenaient de l’érection d’une terre titrée ultérieurement aliénée. Dans ce cas très fréquent sous l’Ancien Régime, il arrivait que le vendeur continuait indûment à porter le titre du fief dont il s’était dessaisis et que l’acquéreur s’empressait de prendre ce titre, auquel il n’avait aucun droit, à moins d’obtenir une érection nouvelle que l’on appelait lettres de confirmation. Ces confirmations ne représentèrent que 7,5% des érections en terres titrées, soit une proportion marginale par rapport au nombre d’acheteurs qui reprenaient et portaient indûment le titre de leur nouvelle acquisition.
Dans ce cas, les acquéreurs d’une terre titrée ne pouvaient que s’intituler que : « seigneurs de la baronnie de … » si l’agissait d’une baronnie, et de même pour les autres terres titrées.
La seule exception à cette règle furent les baronnies, vicomtés et les comtés anciens, dont l’origine se perdait en des temps très reculés. En effet ces baronnies, vicomtés et comtés transmettaient le titre de baron, vicomte et de comte à quiconque venait à les posséder légalement.
H – Les titres attachés à une terre qui, érigée en marquisat, comté, etc., pour une personne dont la postérité mâle s’éteignait, passait à une branche collatérale de la même famille ou à un descendant en ligne féminine Il fallait une nouvelle création par lettres patentes ; mais on s’en exemptait généralement Quelques personnes ont voulu invoquer, pour se justifier, les expressions des lettres patentes d’érection » en faveur des enfans et descendants mâles et femelles » Ces paroles signifient que le titre passait à défaut d’héritiers mâles, aux filles du nom, mais jamais aux descendants de celles-ci.
I – Les titres qui avaient pour origine la possession d’une charge civile ou militaire. L’usage s’introduisit dès la fin du XVIIe siècle de donner aux officiers généraux, aux présidents au parlement et à quelques autres hauts fonctionnaires les qualifications de marquis, de comte etc… Quoique ces titres irrégulièrement portés eussent au moins dû rester personnels, ils passaient par tolérance aux fils et souvent même aux héritiers collatéraux de ces officiers ou magistrats.
J – Les titres que l’on prenait à l’occasion des honneurs de la cour. Si le présenté n’avait aucun titre, il en choisissait un, celui de duc excepté. On exigeait cette formalité pour donner plus d’éclat à la cour de France. Ces qualifications ne devaient pas passer à la postérité masculine et directe de ceux qui les avaient porté. C’étaient des faveurs personnelles que le roi se réservait de modifier ou de renouveler à la génération suivante lors d’une nouvelle présentation. Ces titres dont leurs porteurs étaient qualifiés dans les actes publics, ont été conservés par les chefs de famille. Pour les différencier des titres réguliers, les généalogistes employaient avant leur indication l’expression de » titré « , alors que celle de » dit » désignait l’appellation de ceux qui s’arrogeaient un titre de leur propre chef.
K – Les usurpations de titres qui n’avaient d’autres excuses que le caprice et la convenance des personnes. Cette classe de possesseurs de titres nobiliaires, de loin la plus nombreuse, n’a jamais cessé d’augmenter de jour en jour sous l’Ancien régime et même encore aujourd’hui. Le plus léger prétexte suffisait aux usurpateurs. L’un invoquait une qualification échappée par mégarde des lèvres d’un souverain ou d’un prince ; l’autre une souscription de lettres. Ceux-ci plus francs n’invoquent pour se justifier que leur bonne naissance ou leur grande fortune. Ils prenaient un titre dans les actes, ou même seulement dans des faire-part ; ils le mettaient sur leurs cartes de visite, on le leur donnait dans les salons et la tolérance du Monde sanctionnait le fait accompli.