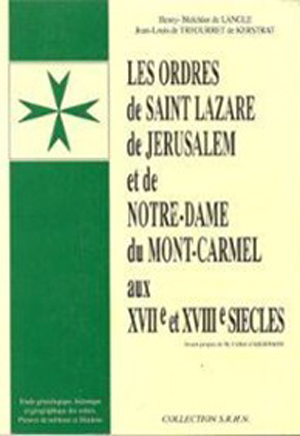Une qualification caractéristique de la noblesse :
Il ne fait aucun doute qu’il nous faille remonter aux temps les plus anciens de la chevalerie pour retrouver l’origine du nom d’écuyer.
La Roque estime que l’étymologie de ce mot
« vient de ce que les nobles ont toujours porté les écus et les armoiries, qui sont les plus visibles marques de la noblesse. »
Mais il pense aussi qu’il puisse venir d’écurie,
« parce que les écuyers avaient soin des chevaux qui appartenaient aux chevaliers ».
La plupart des auteurs, cependant, s’accordent plus volontiers sur le premier sens, et mentionnent l’étymologie d’écuyer comme étant « scutifer » ou « scutarius » : porteur de l’écu.
Claude Fauchet rapporte que sur d’anciennes chartes latines le Grand Écuyer de France est nommé scutifer parce qu’il porte l’écu du roi.
D’ailleurs La Roque ne continue-t-il pas en rappelant que :
« L’écu, ou bouclier, était si considéré qu’on punissait ceux qui l’abandonnaient, et non pas ceux qui quittaient la lance, parce que l’écu servait comme de rempart et de défense dans l’armée. »
A l’époque féodale donc, l’écuyer, jeune noble effectuant son apprentissage auprès du chevalier, l’accompagnait dans les joutes, lui servait de second et avait la garde de son écu blasonné, de sa devise et de ses symboles.
Puis, peu à peu, le terme d’écuyer allait prendre une importance et une signification telles que tous les gentilshommes, même parmi les plus importants, en revendiqueront bientôt la qualité.
« C’était le temps ou la chevalerie étant particulièrement à l’honneur, personne n’imaginait de dignité plus relevée que celle qu’elle conférait. » écrit le vicomte de Marsay qui cite M. de Ludre, rappelant qu’avant 1500 : « Les plus grands seigneurs s’intitulaient tantôt écuyers, tantôt chevaliers, et que les princes de sang royal eux-mêmes ne rougissaient pas de la qualification d’écuyer. ».
En même temps qu’au déclin de la chevalerie, on assiste au plein essor de la noblesse, et la condition d’écuyer va perdre rapidement son prestige. Elle ne le retrouvera que lors de la seconde moitié du XVIe siècle, époque à laquelle les qualités d’écuyer et de noble vont se voir de nouveau rattachées l’une à l’autre.
Déjà le 30 septembre 1554, un arrêt du parlement considéra la qualification d’écuyer comme caractéristique de l’état nobiliaire. Puis l’ordonnance des États de Blois, en mai 1579, ratifiera indubitablement la mutuelle dépendance de ces deux qualités.
Art 257 : « S.M. veut que l’ordonnance faite sur la remontrances des États tenus à Orléans soit gardée contre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le titre de Noble, prendraient le nom d’Écuyer et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu’ils soient muletés d’amendes arbitraires. »
Cette ordonnance fut confirmée par un édit du roi en mars 1583.
Outre cette dépendance « Ecuyer-Noble », la qualification d’écuyer fut de surcroît subordonnée à la seule noblesse héréditaire, excluant de ses rangs la noblesse acquise dans les fonctions civiles.
L’article 25 de l’édit de mars 1600 l’atteste :
« …S.M. défend à toutes personnes de prendre le titre d’écuyer, de s’insérer au corps de la noblesse s’ils ne sont issus d’un aïeul et père qui ayent fait profession des armes ou servi au Public en quelques charges honorables… »
L’atteste également l’article II de l’édit de janvier 1634, contenant le règlement sur les tailles :
« Défendons à tous nos sujets d’usurper le titre de noblesse, prendre la qualité d’écuyer et porter armoiries timbrées, à peine de 2.000 livres d’amende, s’ils ne sont de maison et extraction noble. »
Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, par le développement important de la noblesse, la qualification d’écuyer se répandit, « se vulgarisa étrangement ».
Perdant sa signification première, la qualification d’écuyer venait à exprimer tout simplement la noblesse à celui qui la portait.
« Le fils du plus modeste secrétaire du Roi ou du plus petit officier municipal, écrit le vicomte de Marsay, eut désormais autant de droit à cette appellation que les descendants des races chevaleresques. »
Parmi les nombreuses charges et emplois conférant la qualité d’écuyer, citons de façon non exhaustive, les gardes du corps du roi et de la reine, les gardes du château, les gendarmes et les chevau-légers, les prévosts-généraux provinciaux et particuliers, vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe-courte, leurs lieutenants, assesseurs, les procureurs du roi …
La liste est longue, même si l’octroi de la qualité d’écuyer ne vaut pour la plupart que tant que l’individu est revêtu de sa charge seulement.
Rappelons par exemple, l’arrêt du Conseil du 24 mars 1699 qui permet aux porte-manteaux et aux huissiers de la chambre et du cabinet du roi, de prendre la qualité d’écuyer
« tant qu’ils seront revêtus de leurs charges, ou qu’ils en auront obtenu des lettres de vétérance après vingt-cinq ans de service, sans qu’ils puissent prendre cette qualité, s’ils se démettent desdites charges avant ledit temps, et sans qu’en aucun cas, ladite qualité d’écuyer puisse passer à leurs descendants. »
Au-delà de toutes considérations, les qualifications d’écuyer étaient devenues, c’est certain, propriété de la noblesse, elles en constituaient le témoignage.
En outre, par l’adjonction de certaines mentions, les qualifications d’écuyer étaient censées indiquer l’ancienneté de la noblesse.
Jean Meyer explique qu’en Bretagne, une différence très nette existait entre l’écuyer de « simple extraction » et celui « d’ancienne extraction ».
« Le premier, écrit-il, a prouvé trois partages nobles successifs, soit, en gros, un siècle d’ancienneté. […] Un écuyer d’ancienne extraction prétend à une origine plus ancienne – au moins au XVe siècle … »
L’auteur continue en précisant que la mention « d’extraction » n’excluait néanmoins pas que la noblesse n’ait pu être remontée plus haut, mais seulement que le possesseur n’avait pu apporter de preuves plus anciennes.
Cela dit, devant l’importance de la signification des qualificatifs, l’on comprend parfaitement que ce fut principalement sur eux que se reposèrent, en établissant une filiation, les généalogistes lors de leurs enquêtes et de leurs recherches sur les faux nobles, tant lors de la grande Réformation de 1668-1672, que lors de celles qui suivirent.
« Quelle confiance […] peut-on prendre […] dans une preuve de noblesse qu’une famille […] tenterait d’établir depuis l’année 1688, lorsqu’on sait qu’en 1696, c’est à dire huit ans après, les usurpations s’étaient multipliées à un tel point que Louis XIV, pour en réprimer le progrès, fut contraint de faire procéder de nouveau à la recherche des faux nobles qui, ayant été commencée en 1666, avait été suspendue en 1674 à cause des guerres. » écrit Chérin.
Ainsi, pour prouver sa noblesse dans la plupart des États du royaume, explique ce généalogiste, il est nécessaire de produire, sur chaque degré, des titres qui établissent la filiation et dans lesquels les sujets soient qualifiés de nobles, écuyers, chevaliers etc.
Une exception cependant en Bretagne, où il était exigé la production d’au moins trois partages nobles successifs.
« Ce second moyen, écrit toujours Chérin, est particulier à la province de Bretagne. […] Il est d’autant mieux fondé […] qu’anciennement la noblesse n’y prenait souvent aucune qualité dans les titres, et qu’il ne lui restait d’autres preuves de son état que les partages nobles. »
Jean Meyer nie fermement d’ailleurs, cette dernière constatation.
A la fin de l’ancien Régime, la qualification d’écuyer perdit de son importance et de sa signification. En effet, l’état s’étant constitué une source de revenu non négligeable grâce aux nombreux anoblissements concédés et s’attachant de moins en moins à l’intégrité de la noblesse, « commença à pratiquer une tolérance qui devint bientôt de la complaisance. »
Marcel Marion rapporte que le vicomte de Toustain, dans un mémoire sur les corvées présenté aux États de Bretagne en 1776
« pensait que des amendes sévères sur ceux qui depuis vingt ans avaient usurpé le port d’armes et la qualité d’écuyer formeraient un appoint considérable à la confection et entretien des routes. ».
On se désintéressa peu à peu des usurpations des qualifications d’écuyers dans la vie courante, aussi voit-on nombre de bourgeois les usurper dans les actes notariés et même dans ceux de l’état civil, écrit le vicomte de Marsay.
Omission de qualification :
L’omission de la qualité d’écuyer, pendant cent ans, fait-elle perdre la noblesse dans tous les cas ? Des lettres de relief, ou des lettres de nouvel anoblissement sont-elles nécessaires ? Antoine Maugard se prononce dans son ouvrage en indiquant un certain nombre d’éléments ; non sans avoir rappelé en premier lieu qu’en France aucune loi ne s’explique clairement sur cette question.
Une loi spécifique aux colonies :
« Il existe, il est vrai, dit Maugard, des lettres patentes, en forme d’édit, concernant les anoblissements dans les colonies françaises & les preuves de noblesse à faire dans le royaume par les habitants des colonies ; données à Versailles le 24 Août 1782 ; registrées à la cour des aides le 18 décembre suivant, sans aucune modification par lesquelles il semble que l’on ait voulu introduire une nouvelle doctrine inconnue non seulement aux auteurs qui ont traité de la noblesse, mais encore aux différentes cours souveraines qui ont eu souvent à prononcer sur des difficultés qui ont beaucoup de rapport à celles dont il s’agit ici.
Par l’article III de ces lettres patentes il est ordonné « que les anoblis ou ceux de leurs descendants nés dans les colonies, qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indépendamment de leurs lettres d’anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse & des titres & actes nécessaires pour justifier de leur filiation & possession de noblesse, un acte de notoriété du Conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera établi, portant que les anoblis, depuis la date de leurs titres d’anoblissement, & leurs descendants n’auront exercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus ; qu’ils auront pris les qualités nécessaires pour la conserver ».
Il faut observer que cette loi n’est pas générale : elle est faite, uniquement & spécialement, pour les colonies : elle ne peut s’appliquer aux preuves de noblesse des habitants des provinces du Royaume ; pas même de ceux du ressort de la Cour des Aides de Paris qui l’a enregistrée. »
En fait, Antoine Maugard soutient que ces lettres sont rédigées uniquement en vue d’éviter les fraudes qui pourraient avoir lieu dans les colonies « un pays séparé du Royaume par dix-huit cents lieues de mer » et dans lequel le commerce est la principale occupation des habitants.
Cependant, estime notre généalogiste, cette loi ne stipule pas quelles sont les qualités nécessaires pour conserver la noblesse, et semble laisser la décision aux commissaires chargés de l’examen des preuves.
« Où les habitants des colonies apprendront-ils à connaître quelles sont ces qualités ? Aucun livre n’en parle : & la loi se tait ! …
[…]
… c’est dans les principes du droit commun & de la justice, dans la jurisprudence des cours, qu’il faut chercher la solution demandée. »
Prééminence de la vie noble :
« Une maxime certaine, qui est de tous les temps & de tous les pays, c’est que les droits du sang sont inviolables & que les ordonnances civiles ne peuvent jamais les détruire. Or la noblesse, que l’on appelle naturelle, qui est celle que l’on tient, par droit de naissance, de celui qui en jouissait, soit par bénéfice du prince ou de la loi, soit par une possession immémoriale, à laquelle on ne peut objecter une preuve de roture antérieure, cette noblesse, dis-je, est un droit du sang, un droit de même nature que celui de parenté. Par conséquent celui qui la possède ne peut jamais la perdre, ni l’aliéner : il ne peut pas même y renoncer par une convention particulière. »
En cela Maugard rejoint les principes défendus par son « rival » Chérin qui écrit dans le discours préliminaire de son « abrégé chronologique », à propos de la nécessité d’obtenir des lettres de réhabilitation en cas de dérogeance ou d’omission :
« Le plus grand nombre des Jurisconsultes pense même que la Noblesse d’ancienne extraction, sans principe connu, est une propriété inhérente à la race, qui contient en elle-même un caractère indélébile, et qu’altérée ou obscurcie par plusieurs degrés, elle se relève, de sa propre force, par les seules droits du sang. »
Et Maugard de continuer en affirmant que la vie noble prime sur les qualifications :
« Il semblerait donc que la noblesse, lorsqu’elle est certaine, & fondée soit sur un anoblissement quelconque, soit sur la possession immémoriale, ne peut s’éteindre que par une dérogeance réelle : & qu’une dérogeance, seulement présumée, n’est pas un motif suffisant pour faire déclarer roturier celui à qui elle peut être objectée.
On pourrait dire que si la possession de la qualité d’Écuyer, ou autre caractéristique de noblesse, ne suffit pas, seule, pour acquérir ou conserver la noblesse ; l’omission de cette qualité ne doit pas plus suffire pour la faire perdre. Or il est certain que ce n’est pas la qualité prise dans les actes qui confère ou conserve la noblesse, c’est la vie noble. Car, dans la supposition contraire, il n’y aurait jamais de dérogeance : un gentilhomme forcé à prendre l’état de procureur, de marchand ou autre pareil, ne manquerait pas de faire des actes secrets dans lesquels il aurait soin de cacher sa véritable qualité, pour ne montrer que celle d’écuyer. Aussi, lorsque les cours souveraines ont à juger sur l’état de quelqu’un dont la noblesse est équivoque, elles ne s’en tiennent pas aux titres seuls si l’on n’y voit que la qualité d’écuyer : elles ordonnent qu’il sera prouvé par témoins que ceux qui ont pris la qualité d’écuyer étaient réputés nobles, suivant la commune renommées ; qu’ils n’ont fait aucun acte dérogeant à la noblesse ; qu’ils ont vécu noblement. »
La cour des aides : Une doctrine
Maugard, pour appuyer sa thèse, s’en remet aux principes développés par la cour des aides qui soutient que lorsque la noblesse est certaine, l’omission de la qualité d’écuyer n’est point regardée comme une dérogeance, et qu’en de tels cas des lettres de relief ne sont pas nécessaires.
Aussi cite-t-il les affirmations énoncées dans les premières éditions du mémorial alphabétique de cette cour, au mot «Écuyer » :
« Ce n’est pas une dérogeance d’avoir omis de prendre la qualité d’écuyer ; en sorte qu’un noble, contre lequel on rapporterait des actes qu’il aurait passés sans cette qualité, ne serait pas nécessité d’obtenir des lettres de reliefs, si d’ailleurs il avait d’autres titres qui justifiassent sa noblesse. Mais faute d’autres titres & si la plupart de ceux qu’il rapporte lui même ne contiennent pas cette qualité, on le présume roturier ; parce que les nobles sont assez jaloux de cette qualité, pour ne la pas négliger : &, en ce cas, il faut qu’ils prennent des lettres de relief d’omission de ladite qualité. »
Et de continuer par les précisions ajoutées dans l’édition in-4° de 1742 :
« Cependant l’ancienne noblesse qui s’acquéroit autrement que par les services militaires, surtout par le service dans les Cours, ne prenait point la qualité d’écuyer, qui était peu convenable à son état, auquel néanmoins on n’a pu contester jamais les avantages de la noblesse transmissible. »
L’omission de la qualité d’écuyer : Le Conseil confirme.
En ce qui concerne le Conseil, Antoine Maugard rappelle que les « traitants », auxquels avait été vendue la « faculté indéfinie de tourmenter les nobles », avaient pris soin de notifier plusieurs fois leur avis sur la question, et que jamais ceux-ci n’avaient pu remettre en cause le fait que l’interruption de la qualification d’écuyer n’était nuisible.
Belleguise, l’un de ces traitants, écrit notamment, à propos des professions de juge royal, médecin ou avocat, que les descendants de ceux-ci ne pouvaient retirer préjudice de ces qualités et que :
« puisqu’un titre d’écuyer, qui n’est souvent qu’un nom de montre & de parade, leur pouvait conserver la noblesse ; celui de juge, de médecin, ou d’avocat, aussi glorieux qu’utile, ne devait pas la leur faire perdre, ou plutôt en affaiblir la preuve »
Et Maugard d’ajouter l’arrêt du Conseil du 4 juin 1668, qui se prononce ainsi :
« Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné que, dans les titres qui seront produits par les particuliers assignés pour justifier de leur noblesse, la qualité de juge royal, d’avocat, ou de médecin, ne pourra estre réputée faire tige de noblesse, si elle n’est établie par une possession de qualité d’écuyer ou de noble : néanmoins, en cas que ladite qualité d’écuyer soit établie par titres authentiques & valables, celle de juge royal, d’avocat ou de médecin, seulement & sans qualité de noble ou d’Écuyer, ne sera point censée déroger. »
De cet arrêt, Maugard en conclut trois points décisifs :
« 1°. Que l’omission de la qualité de noble ou d’écuyer ne fait pas perdre la noblesse, lorsqu’elle est prouvée par titres authentiques & valables & seulement par une possession suffisante, antérieure à l’omission : 2°. Que l’omission d’une qualité noble ne fait perdre la noblesse, que lorsque celui qui a omis de la prendre a exercé un état incompatible avec la noblesse. 3°: Qu’il ne faut point de lettres de relief, puisqu’il autorise les commissaires à maintenir ceux qui se trouvent dans ce cas, sans mettre aucune différence entre la généalogie où il n’y a omission que sur un degré & celle où l’omission a été continuée pendant plusieurs générations. »
En outre, il étend ses positions non aux seules professions citées plus haut, mais à d’autres et notamment aux « emplois de finance ».
Conclusion : Le fondement de la noblesse est déterminant
Maugard se résume lui-même :
« Ier. CAS. De la noblesse fondée sur un anoblissement certain :
Elle est imprescriptible, elle ne peut se perdre que par la dérogeance: l’omission de qualité ne peut aucunement préjudicier ; & fût-elle continuée pendant cent ans & plus, il ne faut point de lettres de relief, lorsqu’il est prouvé que ceux qui ont oublié de prendre la qualité d’écuyer ont exercé un état compatible avec celui de la noblesse.
On peut en dire autant de la noblesse réputée d’ancienne chevalerie, quant à l’omission de qualité : il est certain qu’elle ne peut lui nuire en aucune manière. A l’égard de la dérogeance, il serait facile de prouver qu’il n’en est point qui puisse faire perdre la noblesse à un gentilhomme d’ancienne chevalerie ; mais cette question est étrangère à celle qui vient d’être agitée.
IIe. CAS. De la noblesse fondée sur la possession centenaire :
1°. L’omission de la qualité d’écuyer ne nuit point, & il ne faut point de lettres de relief, lorsqu’il est prouvé, par titres, que ceux qui ont oublié de prendre cette qualité n’ont pas cessé, pour cela, de jouir des privilèges de la noblesse, ou qu’ils ont exercé un état compatible avec elle ; parce qu’alors il est certain qu’il n’y a point eu de dérogeance.
2°. L’omission de la qualité d’écuyer pourrait nuire, & il faudrait des lettres de relief, s’il n’était pas prouvé clairement que ceux qui ne l’ont pas prise aient constamment joui des privilèges ou aient exercé un état compatible avec la noblesse : parce qu’alors il y aurait du doute sur leur état ; & ce doute ne peut être levé que par des lettres du prince. Ces lettres ne sont pas de grâce, mais de justice.
3°. L’omission de la qualité d’écuyer, continuée pendant cent ans, fait perdre la noblesse ; lorsqu’il est prouvé, par titres, que ceux qui ne l’ont pas prise ont payé les impositions roturières sans réclamation ; quand même ils auraient exercé un état compatible avec la noblesse : parce qu’alors la noblesse qui avait été acquise par le droit de la prescription est anéantie par le droit contraire, & l’on présume, avec raison que la possession de la qualité d’écuyer était une usurpation : de manière que des lettres de relief, même de dérogeance, ne suffiraient pas pour la rétablir. Il faut des lettres d’anoblissement. Comme ce sont des lettres de grâce, & qui dépendent absolument de la volonté du roi : on ne pourrait pas se flatter de les obtenir. »
Écuyer : Un titre ?
En examinant les diverses études réalisées, il paraît incontestable qu’au XVIIIe siècle et avant, le terme d’écuyer reflète uniquement une qualité et se différencie des autres titres de noblesse tels que baron, vicomte, comte, marquis, prince ou duc ; cela en dépit du fait que dans bien des textes l’expression «titre d’écuyer» est de nombreuses fois employée.
A ce propos, MM. Guérin citent notamment le discours préliminaire de Chérin, l’édit de mars 1600 (voir plus haut) faisant défense de «prendre sans droit le titre d’écuyer», une déclaration du 4 septembre 1696 ayant le même objet…
Mais nous pensons qu’en cela le mot « titre » est employé dans son sens original. Du latin « titulus » qui signifie notamment « inscription – titre d’honneur », « titre » doit être considéré alors comme une désignation honorifique, une dignité.
En outre, l’on s’aperçoit que quatre principaux points paraissent différencier, sous l’ancien régime, la qualification d’écuyer des titres de noblesse comme nous les entendons, sans pour autant les opposer.
Le premier d’entre eux, qui semble être une évidence, est que le terme d’écuyer, à l’inverse des titres, n’avait pas d’équivalent féminin. – Même si MM. Guérin indiquent dans leur ouvrage que le titre de demoiselle correspondait, pour le genre féminin, à la qualification d’écuyer, affirmation également développée par M. Alain Texier dans son ouvrage sur la noblesse :
« Les titres de dame ou de demoiselle, eux, ne sont plus portés aujourd’hui en France. Leur existence juridique est pourtant certaine. Demoiselle est l’équivalent féminin d’écuyer et dame celui de chevalier […] »
En deuxième lieu, contrairement au qualificatif d’écuyer, la dévolution d’un titre jusqu’à la Révolution, restait liée à la possession d’une terre érigée en fief de dignité par des lettres dûment enregistrées en parlement. Cela, même si bien souvent, ainsi que le soulignent la plupart des érudits auteurs d’ouvrages sur la noblesse, nombre de titres irréguliers furent portés dans la vie publique sans aucun empêchement, notamment au XVIIIe siècle.
Le troisième point est directement lié à la dévolution du « titre ». En effet, si « écuyer » était un titre à part entière, il ne serait transmissible que par ordre de primogéniture.
Enfin, quatrième et dernier point, si le titre exprimait une dignité particulière, une marque d’honneur, il venait, en complément du qualificatif d’écuyer ou de chevalier même si ces derniers n’étaient quelquefois plus alors cités : dans les preuves de noblesse pour la Grande Écurie, le bisaïeul de l’impétrant, est dit :
« Marc-Comte Bardon, écuyer, baron de Segonzac » ; son aïeul est dit : « François-Louis, chevalier, baron de Segonzac » ; enfin son père est dit : « Marc-Comte Bardon, baron de Segonzac. »
Dans les preuves de noblesse pour entrer à la Maison Royale de l’Enfant-jésus, Louis d’Aumale, aïeul de Marie-Charlotte est dit :
« écuyer, seigneur et vicomte du Mont de Notre-dame »
Comme on peut le constater, sous-entendu ou pas, le terme d’écuyer, ou celui de chevalier, restait la marque de noblesse. Le titre, quant à lui, était directement attaché à la terre, si l’on excepte au XVIIIe siècle les cas particuliers que constituent les titres à brevets.
Restait à savoir, si au XXe siècle, il serait envisageable de considérer le terme d’écuyer comme un titre à part entière, ou bien au contraire seulement et toujours comme marque de qualité.
Ainsi que l’écrit Hamoir «écuyer» est marque de qualité si l’on conçoit la noblesse comme étant elle-même une qualité. Or, à présent la noblesse n’est bien souvent comprise que seulement comme un titre d’honneur par lequel s’efforcent de se distinguer certains hommes des autres hommes.
Alors Hamoir d’écrire :
« … dans une société régie par des lois égalitaires, niant l’existence de conditions attachées à la naissance, la noblesse se réduit juridiquement à une distinction honorifique. Dès lors, une marque de noblesse n’est plus une marque de qualité, mais une marque d’honneur et elle devient un titre nobiliaire. »
Nous continuerons ce point particulier en rappelant qu’une décision du Ministère des Finances de 1817, fixe un droit de greffes concernant les « titres de marquis, vicomte et écuyer » et les considère comme semblables aux titres de comte, baron et chevalier.
La loi du 8 août 1947, estiment MM. Guérin, ayant repris les termes de l’ordonnance de 1817, cette décision reste encore en vigueur de nos jours. Alors, poursuivent ces auteurs :
« A défaut de lettres confirmatives de noblesse, le ministre de la justice aurait pu légalement prendre les arrêtés portant vérification du titre d’écuyer ; mais depuis 1830, les familles ne s’en sont guère souciées. »
Et pourtant… En 1959, M. N… demande au juge judiciaire la reconnaissance du titre d’écuyer attaché à la charge de son ancêtre :
« Un sieur N. ayant acquis une charge de conseiller-secrétaire du Roi en la chancellerie près le Parlement de Bordeaux en fait enregistrer les provisions le 21 décembre 1785. Le voici décoré du titre d’écuyer et, après vingt ans d’exercice, il a l’espoir de transmettre cette qualité à ses enfants. Mais arrive la Révolution et, de plus, il meurt en 1793. Son fils ne réagit pas sous la Restauration et un lointain descendant direct demande aux tribunaux de l’inscrire dans l’état civil sous les appellations de messire et d’écuyer. »
[…]
« Pour justifier sa demande, le requérant faisait valoir qu’écuyer est un titre et que le titre est la propriété d’une famille, une fois concédé. »
Mais la cour de Douai s’est déclarée incompétente par un arrêt du 19 octobre de la même année, au motif que :
« Si les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la dévolution et à la transmission des titres contestés ou sur leur revendication, par contre, il appartient, exclusivement, à l’autorité administrative de se prononcer sur la validité, la vérification, le sens et la portée des actes souverains de collation ou de confirmation des titres nobiliaires lorsque leur interprétation ou leur existence est sujette à discussion ».
Aussi, M. N… s’est-il alors adressé au garde des Sceaux afin d’obtenir son inscription sur les registres du Sceau de France comme ayant succédé au titre d’écuyer de son ancêtre.
Mais, par un arrêté du 17 mars 1989, le ministre de la Justice ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la demande de M. N… pour la vérification du titre d’écuyer, un jugement du tribunal administratif du 10 février 1994 répond sans ambiguïté à cette question et clôt définitivement, semble-t-il, ce point.:
« Vu, le décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, le décret du 28 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu la loi N° 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18 s ;…
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
[…]… le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du recours de M. N… dirigé contre cette décision ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
Considérant que pour demander l’inscription du titre d’écuyer sur les registres du Sceau de France, M. N… soutient que celui-ci est un titre de dignité semblables aux titres de duc, marquis, comte, vicomte et barons habituellement inscrits et que la circonstance qu’aucune demande en ce sens n’ait été présentée depuis 1830 ne fait pas obstacle à sa vérification ; que son ancêtre Jean-Baptiste N…, […], était bien revêtu de ce titre dès sa réception dans sa charge de conseiller-secrétaire du roi Maison et Couronne de France en la chancellerie près le parlement de Bordeaux et que ce titre était transmissible bien que le dénommé Jean-Baptiste n’ait pas exercé son office pendant vingt années ;
Considérant que dans l’ancien droit nobiliaire français un titre de dignité était, sauf coutumes locales ou dispense d’érection de fief, assis sur un fief et propriété du seul chef de famille ; que seuls ces titres de dignité sont susceptibles d’être inscrits sur les registres du Sceau de France en tant qu’accessoire honorifique du nom ; que le titre d’écuyer était, en revanche, un titre indépendant de toute possession de terre et transmis à tous les membres masculins d’une famille ; qu’il était, dès lors, lié à la qualité des personnes, qu’elles fussent nobles ou titulaires d’offices conférant certains privilèges de la noblesse ; qu’un tel titre qui ne saurait être regardé comme un accessoire honorifique du nom, n’est pas susceptible d’être inscrit sur les registres du Sceau de France ;
Considérant au surplus qu’en admettant même que le titre d’écuyer ait été conféré à son ancêtre en même temps que la noblesse, le requérant ne saurait utilement soutenir que ce titre aurait été transmis dès cette date héréditairement à tous les enfants et héritiers mâles nés et à naître de M. Jean-Baptiste N…. dès lors que, l’abolition de la noblesse et des titres nobiliaires par lettres patentes de Louis XVI données le 23 juin 1790 ne constituant pas un cas de force majeure, la condition d’avoir exercé son office pendant une durée de vingt ans pour pouvoir transmettre cette qualité à ses héritiers n’est pas remplie ; qu’il suit de là que la requête de M. N…, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 1989 du ministre de la Justice décidant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération sa demande de vérification du titre d’écuyer, doit être rejetée ; …[rejet]
(Mme Vettraino, rapporteur ; M. Coutau-Bégarie, commissaire du gouvernement)