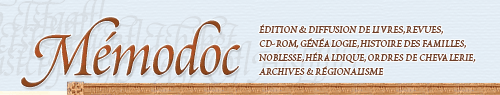 |
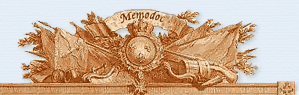 | ||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
Librairie | Les Nouveautés
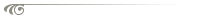
| DICTIONNAIRE DES OFFICIERS GENERAUX DE L'ARMEE ROYALE 1688-1762 - Tome IV - P à Z | |||
BODINIER, G. | |||
 |
Le dernier volume de cette deuxième série complète en amont les volumes déjà parus pour la période 1763-1792. Il comprend 443 biographies et 288 armoiries et est suivi d’un supplément, d’un errata et d’un addenda pour l’ensemble des volumes. Ce sont au total près de 4 700 généraux qui ont été étudiés. Ces volumes seront complétés par un dictionnaire des 450 officiers généraux de la marine qui ont servi entre 1688 et 1792. Cet ouvrage reprend en l’étoffant la Chronologie historique militaire du commis de la guerre Pinard, en y ajoutant des notices relatives aux brigadiers de cavalerie et des dragons. Il étudie tous les aspects de la vie publique et privée des généraux, notamment ceux qui ont été pourvus d’emplois à la cour ou ont été ambassadeurs et ministres, et donne des éléments généalogiques souvent inédits sur leurs familles et sur leurs épouses. Les sources utilisées proviennent des archives du Service historique de la Défense, des mémoires de leurs contemporains et des études biographiques et généalogiques qui ont été consacrées à ces officiers. L'auteur : Gilbert Bodinier. Auteur d’une thèse consacrée aux officiers français combattants de la guerre d’Indépendance des États-Unis, Gilbert Bodinier a passé de longues années à étudier la société militaire sous l’Ancien Régime. Il a participé au Dictionnaire d’art et d’histoire militaire d’André Corvisier et au Dictionnaire du Grand Siècle de François Bluche. Il a déjà publié plusieurs dictionnaires biographiques : le Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d’Indépendance (1776-1783) (4e éd., Paris, 2005), Les gardes du corps de Louis XVI. Étude institutionnelle, sociale et politique. Dictionnaire biographique (Paris, 2005), Les officiers du Consulat et de l’Empire (Paris, 2014) et le Dictionnaire des officiers généraux de l’armée royale (1763-1792) (Paris, 2016). | ||
| |||

| LES GRAND MINISTRES DES HABSBOURG | |||
BLED, J.P. | |||
 |
La grandeur de l'Autriche est d'abord l'œuvre de ses souverains, les empereurs qui se succédèrent de 1450 à 1918. Mais ceux-ci n'auraient pu accomplir leur mission sans le concours des ministres qui les assistèrent. C'est toute l'originalité de ce livre qui propose neuf portraits de grands serviteurs de l'État habsbourgeois. Il commence à la fin du XVIIe siècle quand l'Autriche accède au statut de grande puissance européenne après les victoires sur les Turcs et la reconquête de la Hongrie qui forme dorénavant un ensemble compacte avec le noyau austro-bohême. Il s'ouvre avec la brillante figure du prince Eugène de Savoie. Puis viennent le prince Wenzel Anton von Kaunitz, le principal collaborateur de Marie-Thérèse et le père de l'alliance avec la France de Louis XV ; le prince Klemens Wenzel von Metternich, le vainqueur de Napoléon ; le prince Félix zu Schwarzenberg, le restaurateur du pouvoir monarchique après la révolution de 1848 ; Alexander von Bach, la figure emblématique de l'ère néoabsolutiste ; le comte Friedrich Ferdinand von Beust, l'artisan du compromis austro-hongrois de 1867 ; le comte Eduard von Taaffe qui pratiqua une politique des compromis permanents, la mieux adaptée à la nature pluraliste de l'Autriche-Hongrie ; le baron Max Wladimir von Beck, le dernier grand ministre de François-Joseph, qui fit voter l'adoption du suffrage universel. Cette galerie s'achève avec le Premier ministre hongrois, le comte Istvan Tisza, partisan résolu du dualisme dont la mort en octobre 1918 coïncide avec l'effondrement de la double monarchie. Grand connaisseur de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, Jean-Paul Bled est professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont, chez Perrin, Les Hommes d'Hitler et les biographies de Bismarck – dont il a aussi présenté et annoté les Mémoires –, François-Joseph et Sophie de Habsbourg. | ||
| |||

| LES ROOSEVELT | |||
AYACHE, G. | |||
 |
Plus encore que les Kennedy, le clan Roosevelt est LA dynastie politique américaine par excellence. Sa longévité s’étend sur trois siècles, elle recense plusieurs héros patriotes lors de l’épopée de la fondation des États-Unis, et elle compte dans ses rangs de grands businessmen et philanthropes typiques de l’aristocratie new-yorkaise du XXe siècle naissant. Surtout, cette famille d’origine hollandaise – bien vite scindée entre deux branches distinctes, celle de Hyde Park et celle d’Oyster Bay – donne deux grands présidents. Theodore (au pouvoir entre 1901 et 1909) puis Franklin (à la tête du pays de 1933 à 1945) guident une Amérique agitée par deux guerres mondiales et la Grande Dépression. Le premier, républicain, est l’un des quatre présidents à avoir son visage gravé dans le rocher du mont Rushmore, tandis que le second, démocrate et élu à quatre reprises à la Maison Blanche, initie entre autres le fameux New Deal et rompt avec l’isolationnisme caractéristique des États-Unis. Mais le parcours de cette famille est loin d’être une simple histoire d’hommes : Eleanor Roosevelt, femme de Franklin mais aussi grande diplomate et militante, est aujourd’hui encore le modèle parfait de la First Lady ; tandis qu’Alice Roosevelt, fille de Theodore, rebelle et féministe avant l’heure, fut en son temps une superstar mondiale. Cet ouvrage, digne des meilleures sagas historiques, est le récit d’un pays, d’une famille, mais aussi de nombreux destins, certes liés mais tous uniques. Ancien diplomate et universitaire désormais avocat, Georges Ayache a déjà consacré plusieurs ouvrages à l’histoire des États-Unis et de la politique américaine. Il est notamment l’auteur, chez Perrin, de Joe Kennedy, le pouvoir et la malédiction (2018) et de La Chute de Nixon (2020). | ||
| |||

| MAURICE BARRES | |||
GODO, E. | |||
 |
Écrivain majeur du tournant du XXe siècle, auteur dandy du Culte du Moi, « prince de la jeunesse » qui fut le maître de Mauriac ou de Montherlant, et que chérissaient le général de Gaulle et François Mitterrand, Maurice Barrès (1862-1923) est aussi le chantre du nationalisme, de « la terre et [des] morts », particulièrement impliqué dans l’antisémitisme de l’époque. De ces deux facettes, on a souvent insisté sur la carrière politique de l’auteur des Déracinés, et peiné à trouver une unité. Cet ouvrage, aboutissement de trente-cinq ans de travail, montre les liens complexes et la cohérence secrète entre l’œuvre altière de l’écrivain et l’engagement patriotique de l’homme politique. En ressort une biographie d’une densité et d’une finesse exceptionnelles, sans complaisance pour les aspects noirs de Barrès, mais avec une admiration sans réserve pour son œuvre. La rigueur scientifique d’Emmanuel Godo ne l’empêche pas de nous livrer un ouvrage écrit dans une langue sensible et délicate, à la hauteur de l’exigence littéraire du sujet. La biographie de référence qui fera date. Poète, Emmanuel Godo est professeur de littérature en classes préparatoires au lycée Henri-IV. Il est l’auteur de nombreuses monographies d’écrivains, dont Léon Bloy. Écrivain légendaire. ... | ||
| |||

| L’EMPIRE DE L’ARGENT | |||
TULARD, J. | |||
 |
La Révolution française fut d’abord un changement de société. En sortent ruinés la noblesse d’Ancien Régime, le clergé et les bourgeois qui avaient prêté à l’État. À l’aristocratie succède la ploutocratie. Ce n’est plus la naissance mais la fortune qui devient le critère de la distinction sociale. L’argent joue désormais un rôle essentiel. Comment s’enrichir sous Napoléon ? Par les donations impériales,par le pillage à la faveur de la guerre, par la corruption ou par la spéculation. La France a désormais le regard fixé sur la Bourse, baromètre de l’opinion. C’est l’envers oublié de l’épopée impériale mais qui ne ternit en rien l’éclat des institutions créées et des victoires remportées par Napoléon. Jean Tulard, professeur à la Sorbonne, membre de l’Institut, est l’auteur d’une œuvre considérable sur la Révolution et sur le Premier et le Second Empire. Aux éditions Tallandier, il a notamment écrit Le Monde selon Napoléon (« Texto », 2019). | ||
| |||

| HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE VILLEDON | |||
VILLEDON, M. de | |||
 |
La maison de Villedon tire son origine de l’ancien fief de Villedon en Poitou qui relevait féodalement des baronnies de St Germain sur Vienne et de Champagnac. La famille se divisa au début du XVème siècle, en deux grandes branches, celle des seigneurs de Villedon dans le département de la Vienne, et celle des seigneurs de Gournay dans le département des Deux Sèvres, qui se divisèrent à leur tour en différents rameaux. La famille s’illustra particulièrement dans l’ordre de St Jean de Jérusalem, au point de lui donner huit chevaliers, dont certains, à leur retour de Malte, devinrent commandeurs. Michel de Villedon propose ici avec une grande rigueur une présentation inédite et richement illustrée de sa famille, qui nous permet de la découvrir dans toutes les étapes de son histoire. | ||
| |||

| LA MALÉDICTION DE L’AÏEUL | |||
MOULIN ZINUTTI, E. | |||
 |
Entre généalogie, psycho généalogie, histoire et presque surnaturel, l’auteur dévoile une partie de ses histoires de familles cachées que la plupart du temps nous souhaitons éviter de connaître. Depuis Jacques de Molay jusqu’à l’arrière-grand-mère de l’auteur, de nombreuses circonstances s’enchainent… Nos ancêtres nous ont en effet transmis beaucoup plus que nos traits et nos gènes, et nous sommes parfois victimes ou en tout cas impactés par des histoires dont nous n’avons pas connaissance. Les rayons des librairies s’étoffent sous le poids des manuels de psycho généalogie, les conférences se multiplient, et même les médecins, perplexes, s’interrogent : « Vous n’auriez pas eu un grand-père gazé à Verdun ? » Anecdote authentique…! L’ouvrage se veut de ce point de vue, non seulement un découverte de la généalogie, passion dévorante mais aussi d’une méthode en psycho généalogie…. ERIC MOULIN ZINUTTI, né à Saint-Etienne en 1972 est le fils d’un immigré italien Silvano ZINUTTI et d’une mère française, Annick MOULIN. Maître en Histoire, Licencié en Droit, il est enseignant certifié en Sciences Economiques et Sociales, Généalogiste Professionnel et Historien Régional. Par sa mère il descend du Roi Louis VI le gros et compte dans sa famille maternelle un Maire décoré de la Légion d’honneur par Napoléon III. Après ses études secondaires, il intègre l’Université en Droit Jean MONNET de Saint-Etienne et obtient un Master en Droit Privé. Il crée son cabinet de recherches Généalogiques à Saint-Etienne puis intègre l’Education Nationale tout d’abord comme Maître Auxiliaire en Sciences Economiques et Sociales puis comme Enseignant Certifié. Il enseigne actuellement cette matière au Lycée Saint-Michel de Saint-Etienne ainsi qu’au Lycée Sainte Marie de Saint-Chamond. Il est membre du Cercle Généalogique de la Loire. Il anime également le blog « Généalogie et Histoire ». | ||
| |||

| ETAT DE LA NOBLESSE SAVOYARDE SUBSISTANTE - VOLUME II | |||
ASNIERES DE VEIGY, T. d' et GREYFIE de BELLECOMBE, D. | |||
 |
Le Comte Éloi Amédée de Foras est l’auteur de l’Armorial et Nobiliaire de l’Ancien Duché de Savoie. Ce monument d’héraldique et de généalogie, en 6 volumes, commencé en 1861, a été continué après la mort de l’auteur, survenue en 1899, par le Comte de Mareschal, le Comte de Viry et le Baron d’Yvoire. Mais l’ouvrage fut interrompu en 1950. Voilà maintenant plus de 70 ans que les heureux détenteurs de l’Armorial de Savoie attendent désespérément une suite à cet ouvrage. Un chercheur aguerri à ce genre de travail, déjà auteur d’un ouvrage similaire, Vaubois, général de Napoléon, généalogie, héraldique, histoire, paru en 2014, a décidé de reprendre le flambeau. Thierry d’Asnières de Veigy a entrepris, avec les mêmes méthodes que celles utilisées par le Comte de Foras, en y apportant de nombreuses améliorations, de continuer l’Armorial et Nobiliaire de l’Ancien Duché de Savoie avec l’approbation du Comte Xavier de Foras, arrière-petit-fils du Comte Amédée. Ce travail vise à dresser l’État de la Noblesse Savoyarde Subsistante. En effet, parmi les 811 familles étudiées par Amédée de Foras, seulement 120 subsistaient encore au début du XXe siècle. La plupart d’entre elles ont déjà fait l’objet d’une notice dans l’Armorial de Savoie. En revanche plus de 350 ont été renvoyées au supplément. Ce supplément n’a pas paru longtemps, et s’est arrêté à la lettre "B" plusieurs familles n’ont pas encore été étudiées, et vous serez heureux de les découvrir. Les notices déjà traitées sont corrigées et augmentées dans les générations passées et mises à jour dans les générations actuelles. Pour mener à bien cet immense chantier, l’auteur s’est adjoint un coauteur de mérite, Damien Greyfié de Bellecombe qui lui aussi a déjà écrit plusieurs ouvrages du même genre sur sa famille, en utilisant les mêmes méthodes. Un autre coauteur, non moins méritant, les a rejoints, Christian Regat, connu pour ses nombreuses publications relatives à la Savoie. Les notices généalogiques sont rédigées sur preuves, après dépouillement des registres d’état civil. Près de 4 000 actes ont été photographiés et archivés. Les archives familiales consultées nous ont permis d’apporter une multitude de précisions. Le présent ouvrage, fort de 656 pages est composé de la liste des souscripteurs, d’un armorial des familles en fin de volume, d’une liste des noms cités et bien sûr de 20 notices familiales : d’Alexandry d’Orangiani ; de Brotty d’Antioche ; de Castagnery de Châteauneuf ; de Charbonneau ; de Chessel ; de Chevron Villette ; Fernex de Mongex ; de Grenaud de Saint Christophe ; de Juge de Pieuillet ; de La Forest Divonne ; de Maistre ; Mathieu de Marcley de Saint Réal ; de Menthon d’Aviernoz ; Michaud ; Millet de Faverges et de Challes ; Millet de Saint-Alban ; Pacoret de Saint Bon ; Rebut de Saxel ; de Reydet de Vulpillières et de Viallet de Montbel. Toutes ces notices généalogiques sont agrémentées des blasons des conjoints, de nombreux portraits de famille, ainsi que de reproductions de documents anciens. Plusieurs centaines de blasons des conjoints sont rassemblés et agrandis dans un armorial des familles alliées en fin de l’ouvrage où l’on trouvera la description héraldique, l’origine de la famille et les sources à consulter. Un index des noms cités, permet de retrouver aisément la personne recherchée. | ||
| |||

| QUAND PASSENT LES CHEVAUX DU DESERT | |||
VADON, B. | |||
 |
[L’émir ABD EL KADER, général E.M DAUMAS, THOMAS ROBERT BUGEAUD, duc d’ISLY, le CLAN MAC-CARTHY REAGH, Eugène DUBERN, les de VAULCHIER DU DESCHAUX, Rolland de CHAMBAUDOIN D’ERCEVILLE, Démians D’ARCHIMBAUD et Saboulin DE BOLLENA...| Au-delà des affinités familiales de l’auteur, dont le général Eugène Melchior Daumas était l’arrière-arrière-grand-père, cet ouvrage est un devoir de mémoire mais aussi un travail de recherches au cœur d’un épisode historique important. On ne l’a sans doute pas assez mis en lumière, mais dans le contexte de l’époque, E.M. Daumas et Abd el Kader nourrissaient des projets différents tout en entretenant une singulière connivence dont le cheval était le point de référence. Cette convergence était aussi nourrie du code d’honneur qu’ils partageaient, lié à leurs origines et à leur formation. Bernard Vadon nous propose plus qu’une rencontre inattendue, il nous fait découvrir l’intelligence et l’âme de ceux qui ont fait, et dans le cas présent, forgent la grande Histoire, pour un voyage singulier, d’hier et d’aujourd’hui. | ||
| |||

| JOURNAL DE VOYAGE EN EUROPE | |||
DINO, D. de | |||
 |
La jeune Dorothée de Talleyrand (1793-1862), fille de la dernière duchesse de Courlande, éblouit le congrès de Vienne en 1815 où elle accompagne le grand Talleyrand, son oncle par alliance. Elle y conforte sa personnalité résolument européenne, parlant aisément l’allemand, le français, l’anglais, l’italien et sans doute le russe. Devenue duchesse de Dino en 1817, elle partage la retraite du célèbre diplomate et le soutient lors de la fameuse ambassade de Londres (1830-1834) qui a vu naître la Belgique et l’entente cordiale. À la mort de Talleyrand (1838), elle se retire à Sagan, sur ses terres de Silésie. Auteure d’un célèbre journal, cette infatigable voyageuse, âgée d’une soixantaine d’années, traverse l’Europe et laisse ce manuscrit inédit, rédigé en vieil allemand et superbement illustré d’une centaine de gouaches, conservé à la bibliothèque Jagellonne à Cracovie. Elle y relate ses pérégrinations, de Berlin à Nice puis de Venise à Sagan, en passant par Nuremberg, Munich, Innsbruck, Vérone, Brescia, Milan, Gênes, etc. À chaque étape, elle retrouve de nombreuses connaissances aristocratiques et visite demeures particulières, monuments et églises par passion pour la peinture, l’art et l’histoire. À Nice, villégiature récente des grandes familles européennes et cosmopolites, elle renoue avec l’Europe et ses enfants restés en France et décrit ses visites, ses rencontres et ses émotions. Récit d’une grande dame européenne, ce texte invite à préserver l’harmonie entre les peuples et les nations qui ont construit cette civilisation millénaire. Introduction, présentation et traduction du professeur Laurent Guihéry. Illustrations en couleurs. Tableau généalogique. Index de plus de 300 noms. | ||
| |||

| L’ORDRE DE SAINT MICHEL ET L’ESSOR DU POUVOIR ROYAL | |||
DUTHEIL, P.T. | |||
 |
L’histoire illustrée du mythique ordre de Saint-Michel. Apparus aux XIVe et XVe siècles, les grands ordres de chevalerie médiévaux ont nourri de nombreuses légendes et tout un imaginaire d’honneur et de valeurs courtoises souvent inspirées du cycle arthurien. Ces compagnies chevaleresques telles que la Jarretière en Angleterre et la Toison d’or en Bourgogne furent fondées avec pour objectif de rassembler autour du souverain un cercle de fidèles et plusieurs existent encore aujourd’hui. Institué en 1469, l’ordre français de Saint-Michel demeure méconnu. Longtemps resté dans l’ombre du prestigieux ordre du Saint-Esprit, créé un siècle plus tard par Henri III, il laisse l’image d’une institution improvisée, qui n’a jamais réellement fonctionné, si ce n’est durant les règnes de François Ier et d’Henri II. À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de son créateur, le roi Louis XI, la fondation Saint-Louis, en partenariat avec le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, a souhaité se replonger dans l’histoire de cette « amiable Compagnie » de « Monsieur saint Michel Archange » créée au château d’Amboise. Le destin de cet ordre mérite incontestablement un réexamen posthume. Révélateur de l’essor du pouvoir royal à l’aube de la Renaissance, il se réinventa et évolua au cours des siècles pour demeurer l’une des principales distinctions royales jusqu’à sa mise en sommeil en 1830. Dans le cadre de l’exposition « L’ordre de Saint-Michel et l’essor du pouvoir royal » organisée au château d’Amboise, ce catalogue propose une étude renouvelée de cet ordre de chevalerie royal. TOM DUTHEIL est conservateur-adjoint au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. MARC MÉTAY est directeur du Château royal d’Amboise et secrétaire général de la fondation Saint-Louis. | ||
| |||

| CA’D’ORO, CHEFS D’ŒUVRE DE LA RENAISSANCE A VENISE | |||
Collectif | |||
 |
Cette exposition organisée au sein des galeries Al Thani, à l'Hôtel de la Marine, présente les chefs d'œuvres de la galerie vénitienne Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, dont la fermeture temporaire donne l'opportunité au public parisien de découvrir un ensemble exceptionnel. Le catalogue permet au lecteur d'explorer l'art et l'histoire de la Sérénissime. Peintures, sculptures et objets d'art évoquent tous le faste exceptionnel et la virtuosité artistique de la ville, à travers le regard d'un amoureux de l'art, Giorgio Franchetti. Une première partie est consacrée à l'histoire de ce magnifique palais vénitien du XVe siècle, qui ouvre sur le Grand Canal, dans le sestiere de Cannareggio, délabré quand le baron Giorgio Franchetti le transforma en musée. Le riche mécène y installe sa collection, trente ans après l'avoir acquis. Issu d'une famille de banquiers et d'entrepreneurs fortunés, Franchetti se passionnait pour la musique et pour l'art, et ses goûts l'avaient conduit à parcourir l'Europe entière. La seconde partie présente le catalogue des œuvres des plus grands artistes italiens, essentiellement vénitiens, tels que Pietro Lombardo, Gentile Bellini, Jacopo Sansovino, Mantegna, Titien, Tintoret ou Le Bernin. | ||
| |||

| ECRINS IMPERIAUX, SPLENDEURS DU IIND EMPIRE | |||
Collectif ; Nicolas Botta-Kouznetzoff ; Laure Chabanne ; Anne de Chefdebien | |||
 |
Ces précieux insignes, témoins de l’histoire politique, militaire et diplomatique de leur temps, illustrent pas à pas les grandes étapes du Second Empire et en font revivre les heures brillantes et sombres. Le catalogue de l'exposition est une étude des ordres, décorations et médailles sous le Second Empire regardés, à la fois sous l'angle historique, diplomatique et phaléristique, réalisé grâce au mécénat de la société des amis du musée de la Légion d'honneur. Il permet de revisiter toute l'histoire de cette période clef avec précision et efficacité. C'est aussi une découverte d'un ensemble inédit d'insignes d'une richesse et d'une diversité étonnante avec une couverture photographique exceptionnelle. | ||
| |||

| LES RUSSES BLANCS, EXIL FORCE ET GENEALOGIE | |||
ZNAMENSKI, N. | |||
 |
VOL I : Vous vous intéressez à la Révolution russe de 1917 ou vous avez un ancêtre Russe « blanc », mais que signifie « blanc » ? Il a quitté la Russie au moment de la Révolution ou après la guerre civile, mais que s’est-il vraiment passé à cette époque ? Ce volume comporte quatre grandes parties. La 1e partie fait le point sur les différentes vagues d’émigration russe et tente d’expliquer pourquoi la première est qualifiée de « blanche ». La 2e partie revient sur le contexte historique pour appréhender au mieux la réalité de l’époque. Après une brève histoire de l’Empire des tsars, le contexte social, institutionnel, religieux et éducatif en 1914 est détaillé. La proportion de militaires étant très importante dans la première émigration, un chapitre est consacré à l’armée impériale, un autre aux ordres honorifiques. La 3e partie présente la succession de révolutions et de guerres qui changèrent à jamais le destin de ces populations. La Première Guerre mondiale est abordée sous l’angle du front russe, avec une section consacrée au corps expéditionnaire russe en France. Puis la complexité de la guerre civile et le sort des Armées blanches sont traités dans leur globalité. La 4e partie est consacrée aux trajectoires de l’exode, aux difficultés matérielles et juridiques auxquelles les exilés furent confrontés, ainsi qu’aux actions de secours mises en place pour leur venir en aide. La Russie hors frontières et ses grands centres politiques et culturels sont décrits, ainsi que la destinée de l’Église orthodoxe après la Révolution et la vie des réfugiés russes. Les principales organisations de secours aux réfugiés russes et de l’émigration sont mentionnées avec les sources d’archives pour chacune d’elles. VOL II : Les Russes blancs durent affronter tour à tour la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchévique, la guerre civile, le Grand Exode, la dureté de l’exil (errance, pauvreté, déclassement social), la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Après un premier volume consacré au contexte de leur exil forcé, ce second tome indique les sources d’archives et les pistes à explorer pour reconstituer ces familles dispersées un peu partout dans le monde. L’auteur résume d’abord sa propre histoire familiale et montre que l’on peut remonter le temps même sans parler russe et malgré des données de départ très parcellaires. Il détaille ensuite les particularités de cette recherche généalogique : barrière de la langue, problèmes de datation, modifications de frontières et de noms de villes, relations avec les archives russes, difficultés de paiement, etc. Une 3e partie répertorie les principaux dépôts d’archives concernant les Russes blancs à travers le monde. Consacrée aux recherches en France, la 4e partie explore les archives de l’OFPRA, les dossiers de naturalisation, le fichier central de la Sûreté nationale, le contrôle des étrangers, les archives diplomatiques, etc. La 5e partie est dévolue aux recherches en Belgique : dossiers de la police des étrangers, fonds Cardinal-Mercier, archives russes du musée de l’Armée, etc. La 6e partie se concentre sur les recherches en fédération de Russie et donne des exemples concrets de recherches. Enfin, la dernière partie liste les principaux groupes et pages russophones, anglophones et francophones sur Facebook pouvant faire progresser vos recherches. | ||
| |||

| LES MYTHES DE LA GRANDE ARMEE | |||
LOPEZ, J. & LENTZ, T. | |||
 |
La vraie histoire de la guerre impériale. Conditionnée par le récit héroïque imposé par Napoléon puis par la cohorte de mémorialistes du Consulat et de l’Empire, l’histoire de la « Grande » Armée repose sur un certain nombre de légendes, devenues vérités pour le public car relayées par une historiographie complaisante. Conduite par un génie invincible adulé par ses grognards, temple de l’héroïsme et incarnation de la méritocratie puisque chaque soldat a dans sa giberne un bâton de maréchal, elle vole de victoires en victoires jusqu’à son engloutissement par « le général hiver en Russie » avant de livrer des derniers combats homériques dont la campagne de France et la défaite glorieuse de Waterloo attribuable au choix à l’incurie de Grouchy, à la folie de Ney, à des trahisons ou à la météo plutôt qu’aux manquements de son chef. En regard, la légende noire, d’inspiration anglaise et royaliste, a imposé une poignée de thèmes comme la répulsion de Napoléon envers toute forme de progrès (n’est-ce pas Fulton ?), son mépris de la vie humaine –le fameux « million de morts », le caractère inexpugnable d’Albion sans oublier sa supériorité écrasante sur mer ou dans le maniement au combat de l’infanterie. Afin de rétablir toute la vérité, Thierry Lentz et Jean Lopez ont mobilisé un commando d’authentiques spécialistes pour passer au crible une vingtaine de ces affirmations, parmi les plus célèbres, dans des contributions aussi vivantes que riches en surprises et en révélations. Un exercice salutaire qui renouvelle en profondeur l’histoire napoléonienne. Les auteurs Antoine Reverchon, Michel Roucaud, Stéphane Béraud, Patrick Bouhet, Stéphane Calvet, Frédéric Bey, Pierre Branda, François Houdecek, Jean Lopez, Thierry Lentz. | ||
| |||

| LES FASTES CANONIAUX | |||
Bernard Berthod, Jean-Christophe Palthey | |||
 |
Les croix pectorales font intégralement partie du costume ecclésiastique. Celles qui sont portées par le clergé français, étudiées dans le présent ouvrage, s’inscrivent dans un mouvement plus ample, à la dimension de l’Europe. En effet, ces marques d’honneur ornent la poitrine de nombreux clercs, de la Lituanie à l’Italie méridionale, mais également des chanoines luthériens en Saxe, en Prusse et en Suède. Ces croix pectorales, dont le but est de distinguer et d’honorer, ne sont pas des « hochets » anodins et futiles : elles disent l’Histoire. Elles sont les témoins du monde catholique des XIXe et XXe siècles ; elles expriment le sentiment religieux de générations de clercs et de fidèles, reflet de la dévotion qui a marqué ces deux siècles : la vénération du Sacré-Cœur de Jésus, de l’Immaculée Conception et des saints locaux, ainsi que l’attachement à la papauté à travers le mouvement ultramontain. Elles témoignent également de l’histoire de l’Église de France et de la catholicité. Enfin, elles reflètent l’art décoratif de cette période et le savoir-faire des artistes, architectes, dessinateurs et orfèvres qui ont consacré leur vie à l’art liturgique. Il n’est guère possible de parler de croix pectorale sans évoquer les ecclésiastiques qui la portent ni le vêtement sur lequel elle est portée et l’évolution de celui-ci au cours des siècles, c’est ce à quoi s’emploie la première partie de l’ouvrage. 172 croix pectorales sont décrites selon les codes de la phaléristique et 161 sont illustrées avec leurs variantes, accompagnées d’un commentaire historique, de la description de l’habit de chœur correspondant, d’informations historiques et iconographiques, des sources archivistiques et d’une bibliographie. | ||
| |||

| LES REINES SOMBRES | |||
PUHAK, S. | |||
 |
Au cœur d’un Moyen Âge régulièrement secoué par des guerres de territoire et de succession, deux femmes ont marqué leur temps : Brunehaut et Frédégonde. Épouses de rois mérovingiens, belles-soeurs et rivales, elles régnaient respectivement sur le Nord-Est et sur l’Ouest du royaume franc. Leur affrontement débuta en 570, à l’accès au trône de Frédégonde, ouvrant une période de guerres civiles, de vengeance et de lutte pour le pouvoir qui dura presque quarante-quatre ans. Intriguant sur la scène politique, commanditant des assassinats et levant des armées, elles entraînèrent le royaume dans une vendetta qui ne s’arrêta qu’à la mort de Brunehaut. À travers un récit épique, Shelley Puhak dresse les portraits croisés de Brunehaut et de Frédégonde, deux reines incontournables du Moyen Âge dont la rivalité façonna le royaume franc. L'auteur est poétesse et écrivaine américaine. Professeur Eichner d'écriture créative à l'Université Notre Dame du Maryland. Elle a remporté le prix de poésie Anthony Hecht pour son recueil Guenièvre à Baltimore. | ||
| |||

| LE CHATEAU DE MEDAVY | |||
ROYER-PATIN, A.M. | |||
 |
Voici dévoilées, aux pages d'un beau-livre, les multiples facettes d'un domaine singulier et peu connu, qui compte parmi les plus attachants de l'Orne, entre Perche, Bocage et campagne d'Argentan. Cette noble demeure, qui a retrouvé toute son élégance et sa majesté "grand siècle", nous invite à pénétrer dans son intimité et se raconte au fil ininterrompu d'une histoire qui remonte au Moyen Âge, à travers son architecture, ses décors intérieurs, ses collections remarquables, les personnages marquants qui s'y sont succédés et y ont laissé leur empreinte. Une découverte où se conjuguent avec bonheur passé et présent, richesses du patrimoine et douceur de vivre, dans l'écrin d'un parc traversé d'eaux vives. | ||
| |||

| SIX FRERES DANS LA GUERRE | |||
PASSAGE, E. du | |||
 |
Ce recueil de lettres nous plonge dans une exceptionnelle saga familiale : six frères - dont le célèbre jésuite Pierre Teilhard de Chardin - tous engagés dans la Grande Guerre ! La forte personnalité des frères Teilhard, comme leur attachement à des valeurs communes au sein d’une famille très unie, les aideront à tenir dans un tel « déchaînement de lutte et de douleurs ». Cette correspondance révèle six frères déterminés, courageux, à l’engagement sans faille, qui vont payer un lourd tribut à la guerre : deux seront tués, un grièvement blessé et un autre intoxiqué par les gaz. Petit-fils de l’un des frères, passionné par le premier conflit mondial, l’auteur a pu reconstituer minutieusement le parcours militaire de son grand-père et de ses cinq grands-oncles engagés dans la Grande Guerre, bénéficiant d’archives familiales abondantes – lettres, carnets de guerre, photographies - non exploitées jusque-là. Il est difficile de rester insensible aux destinées croisées de ces six héros discrets à qui, comme beaucoup d’autres, nous devons tant. L'auteur : Né en 1950 à Paris, Emmanuel du Passage est le petit-fils de Joseph Teilhard de Chardin, le quatrième des six frères engagés dans la guerre de 14-18. Il est baptisé par son grand-oncle le père jésuite Pierre Teilhard de Chardin. De famille picarde par son père, Emmanuel habite dans l’Aisne, au cœur de la région où les six frères Teilhard ont tous séjourné et se sont battus pendant la Grande Guerre. Ingénieur de formation, il effectue sa carrière professionnelle principalement dans le domaine des parfums et cosmétiques. Passionné d’histoire et de nature, il est président de l’association SPFC – Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois. | ||
| |||

| MARESCOT, LE VAUBAN DE NAPOLEON | |||
ERMISSE, G. | |||
 |
La première biographie du Vauban de Napoléon Surnommé le Vauban de Napoléon, Marescot fut, de 1800 à 1808 - date de sa chute spectaculaire - un lointain successeur du maréchal de Louis XIV, comme lui à la tête du Génie et des fortifications. Il a contribué à nombre des célèbres victoires de son chef, mais dans l’ombre. Il est aussi le grand « fortificateur » de l’Empire français. Au sommet de la hiérarchie militaire et de la haute société impériale, il est un des supports du trône, sans être un proche de Napoléon. Mais rendu coupable de la catastrophe de Baylen en 1808, il est dégradé, humilié et paye sa prétendue faute de quatre ans de prison sans jugement. Après la chute de Napoléon, il entame une carrière de libéral et devient pair de France sous la Restauration, jusqu’à sa mort en 1832. Une telle existence chahutée, dramatiquement romantique, illustre ce que fut la vie de tant de jeunes officiers depuis les Lumières jusqu’aux premiers moments du « roi bourgeois » Louis-Philippe. Une époque terrible. L’Histoire roulait alors un train d’enfer. C’est aussi un des intérêts de cette biographie singulière que d’éclairer ce moment si particulier de notre histoire. L'auteur : Archiviste-paléographe, historien et juriste, Gérard Ermisse a d’abord exercé son métier dans les Archives départementales, puis a dirigé des services patrimoniaux du ministère de la Culture à Paris comme la Mission du patrimoine ethnologique, l’Inventaire général, l’Inspection générale des Archives de France et enfin les Archives nationales. | ||
| |||

| TRESORS INCONNUS DU VATICAN | |||
BERTHOD, B. | |||
 |
Ce qui se passe derrière les murs du Vatican ne cesse d’intriguer les visiteurs et les touristes de Rome. En présentant les personnes et les objets qui entourent le pape, ce dictionnaire (368 pages, 350 notices, 800 illustrations) permet, non seulement de découvrir bien des trésors – un patrimoine exceptionnel indissociable de la mission du pape –, mais aussi de saisir de l’intérieur l’histoire du siège apostolique et les coulisses de la vie quotidienne au Vatican. | ||
| |||

| PHILIPPE LE BEL, PUISSANCE ET GRANDEUR | |||
KRYNEN, J. | |||
 |
Attentat d’Anagni, persécution des templiers, expulsion des Juifs du royaume, manipulations de la monnaie…, ou, au contraire, première réunion des états généraux. Dans notre mémoire nationale, la figure de Philippe le Bel reste attachée à une dérive autoritaire de la monarchie capétienne. Ce roi a pourtant fait la France à plus d’un titre, et c’est cette œuvre de fondation que ce livre s’attache à restituer. Il donne à comprendre comment, sous l’autorité d’un monarque encore médiéval, a été opéré un véritable modelage idéologique et politique de la France. Le petit-fils de Saint Louis n’a pas seulement "fait la France" par une régénération des moyens et des méthodes d’action de l’État en formation. Son gouvernement antiféodal, ses guerres, sa diplomatie, ses rapports à l’Église, tous participent de la même ambition : instaurer sur le monde chrétien une domination de la France, une domination perpétuelle. Ce dessein n’a pas eu pour seul foyer le Conseil du roi. Il a été secondé sur le terrain doctrinal par de grands universitaires, propagé par d’ardents prédicateurs, mis en œuvre à travers le pays par les officiers royaux et avalisé par les représentants des trois ordres. Autour des années 1300, c’est une remarquable poussée d’orgueil "nationale" qui prend forme, savamment enracinée dans la religion, l’histoire, le sentiment dynastique et le droit. La marque insigne de ce naissant complexe de supériorité du royaume est qu’il ne s’éteindra guère : jusqu’au XXe siècle, la France ne pourra plus se passer de l’idée élective de se voir, et de se vouloir, différente. | ||
| |||

| LE DROIT HIÉROSOLYMITAIN DANS L'ORIENT LATIN DU XIE AU XVIE SIÈCLE | |||
AUDRERIE, L.M. | |||
 |
L'expression « Assises de Jérusalem » désigne de manière habituelle l'ensemble des Livres de droit rédigés pour l'essentiel dans la seconde moitié du XIIIe siècle dans le royaume latin de Jérusalem. Dans la tradition des grands coutumiers contemporains, des jurisconsultes chevaliers de l'Orient latin ont mis par écrit « les assises et les bons us et les bones costumes dou royaume de Jérusalem ». À l'origine, les « Assises » désignent des normes de droit établies en assemblée depuis Godefroy de Bouillon dans le royaume de Jérusalem (1099-1187), consignées dans des chartes portant le nom de « Lettres dou Sepulcre » ; chartes qui ont été perdues avec la perte de Jérusalem en 1187. Ce droit hiérosolymitain ne fut pas oublié et il devient, sans véritable rupture, la coutume partagée du royaume latin de Jérusalem reconstitué à Saint-Jean d'Acre et celle du royaume latin de Chypre. Après la perte de Saint-Jean d'Acre en 1291, le droit hiérosolymitain continua à s'appliquer dans le royaume latin de Chypre et à régir ses institutions et ce jusqu'en 1571 ; année où l'île de Chypre passa sous domination ottomane, ce qui termine alors l'histoire de l'Orient latin. C'est tout l'objet de cette étude que de reconstituer de manière nouvelle l'histoire du droit latin hiérosolymitain, les « Assises de Jérusalem », sur six siècles de 1099 à 1571. Il est établi ici les traces originelles de ce droit, ses origines et ses fondements, sa conservation dans des livres et des miscellanées, mais aussi et surtout sa transmission évolutive à travers les siècles. L'auteur : Louis-Marie Audrerie est docteur en droit de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, il a été pendant plusieurs années professeur de lycée professionnel puis assistant de recherche en histoire du droit à l'Université Paris XII. | ||
| |||

| LE GENERAL LOUIS DE ROSTOLAN, UNE VIE AU SERVICE DE LA FRANCE | |||
ROSTOLAN, M. de | |||
 |
A partir d’archives familiales inédites, enrichis en documentation et complétés par des notices généalogiques, l’auteur retrace la longue carrière militaire du Général Comte, qui participa activement à la conquête de l’Algérie, avant de diriger l’Ecole Polytechnique et d’assurer la charge de Gouverneur de Rome sous le second Empire. | ||
| |||

| L’ARMORIAL DE 1696, PRESENTATION | |||
DELGRANGE, D. | |||
 |
Quand il est promulgué en novembre 1696, l’édit royal organisant le recensement des armoiries en France est censé recueillir l’adhésion du public en offrant à chacun la possibilité de faire enregistrer un écu à ses armes. L’entreprise était de taille, mais a-t-elle pour autant atteint son but ? Dès le début, deux logiques différentes s’opposèrent à son aboutissement : l’une, financière, voulait que l’opération soit menée au plus vite, l’autre, documentaire, demandait du temps et des moyens pour effectuer les vérifications annoncées et éviter les contradictions. | ||
| |||

| LA PRINCESSE BIBESCO – FRONDEUSE ET COSMOPOLITE | |||
TERRAY, A. | |||
 |
Roumaine de naissance, française de plume, la princesse Bibesco (1886-1973), l’un des auteurs les plus lus de l’entre-deux-guerres, rivale de Colette et Anna de Noailles, admirée de Marcel Proust, Rainer Maria Rilke et Paul Claudel, fut un personnage flamboyant. Elle traversa le vingtième siècle en ne laissant jamais personne indifférent sur son sillage. Son originalité séduisait ou agaçait. Jet-setteuse avant l’heure, elle fut une insatiable voyageuse de l’Orient-Express, une intrépide pionnière des airs à bord des premiers avions. Grande séductrice, sa poursuite de l’amour fut passionnée et désenchantée, du roi Alphonse XIII à Henry de Jouvenel. Diplomate de l’ombre, elle fut l’intime de ceux qui font l’Histoire, intriguant subtilement et dangereusement pour défendre les intérêts de son pays et la paix en Europe. Marthe Bibesco a tout vécu, les tragédies de son siècle, les drames intimes et les trahisons, la célébrité, le luxe inouï et l’exil désargenté à Paris à partir de 1945. Pendant onze ans, elle a été séparée de sa fille unique, enfermée en Roumanie communiste. Jamais elle ne s’est résignée. Aude Terray est allée sur ses traces en Roumanie, à Londres et à Paris. Elle nous livre un portrait intime d’une femme incandescente et complexe. L'auteur : Historienne, chroniqueuse littéraire, Aude Terray est notamment l’auteur d’une biographie de Claude Pompidou (2010) et de Madame Malraux (2013). | ||
| |||

| SUCCESSIONS IMPERIALES, LE POUVOIR MIS A NU | |||
FLICHY DE LA NEUVILLE, T. | |||
 |
Pour des Empires prétendant se perpétuer infiniment, toute succession correspond à une période de fragilité et d’agitation. Au-dessous de celui qui l’incarne, la structure haute du pouvoir est soudainement mise à nu. Les soutiens du Monarque croisent le fer avec leurs détracteurs. Les minorités agissantes sont portées à ébullition et peuvent faire appel à des soutiens étrangers pour arriver à leurs fins. En effet, même si la succession est réglée à l’avance, elle se présente comme une fenêtre d’opportunité pour s’emparer du pouvoir. Les périodes de successions impériales génèrent en définitive une agitation ordinaire qui prend la forme d’intrigues de cour. Celles-ci peuvent dégénérer en de graves conflits internes, voire en des guerres mobilisant des puissances étrangères. Face à ces risques gradués, les forces intéressées à la perpétuation pacifique de l’Empire – qu’il prenne la forme d’une monarchie héréditaire ou d’une ploutocratie élective – ont eu intérêt à encadrer soigneusement la succession de façon à éviter tout effondrement dommageable à leurs intérêts. L'auteur : Membre de l’Université de Poitiers, Thomas Flichy de La Neuville est agrégé d’histoire et habilité à diriger des recherches. Ses recherches portent sur la capacité des civilisations à transmettre la vie sur la longue durée. Il dirige la chaire de géopolitique de Rennes School of Business. | ||
| |||

| LE ROI EN SON DUCHE - LA CONSTRUCTION DE L’ARISTOCRATIE ROYALE EN BRETAGNE | |||
LAUNAY, V. | |||
 |
« Le roi en son duché ». En faisant référence, par analogie, à la célèbre formule du XIIIe siècle selon laquelle « le roi de France est empereur en son royaume », ce livre veut identifier les éléments de la présence royale en Bretagne durant la seconde partie de ce que l’historiographie appelle « l’âge d’or capétien ». Alors que le processus de construction de l’État royal est patiemment mis en oeuvre par les souverains capétiens, le cas de la Bretagne constitue un formidable laboratoire où il est possible d’apprécier l’intégration du duché et de son aristocratie au sein du royaume de France. Les mécanismes identifiés par l’historiographie récente (dans les domaines judiciaire, juridictionnel, fiscal, monétaire et militaire) y trouvent une traduction territoriale, notamment par le biais de l’approche cartographique fondée sur l’exploitation de sources souvent inédites. La démarche de l’ouvrage passe par l’analyse du jeu des acteurs : les nobles et les ecclésiastiques, bretons et non bretons ; le duc de Bretagne ; le roi de France et ses officiers. Sur le plan territorial, la pesée de cette intégration au royaume permet d’établir une tripartition du duché éloignée des regards traditionnels qui opposent haute et basse Bretagne : un nord où les marqueurs de la présence du pouvoir royal sont particulièrement visibles ; une partie orientale qui profite de liens étroits noués avec d’importants lignages normands, angevins et poitevins ; enfin, un sud, coeur du domaine ducal plus éloigné du pouvoir royal. | ||
| |||

| LA NAISSANCE DU ROYAUME FRANC DE JERUSALEM | |||
LECONTE, L. | |||
 |
À la suite de la première croisade, quatre États francs sont nés au Proche-Orient. Dans cet ouvrage, Lucien Leconte relate la fondation du plus important d'entre eux, le royaume de Jérusalem. Ce fut l'œuvre d'un homme, Baudouin de Boulogne. Quand les croisés prirent Jérusalem, ils confièrent sa défense à l'un de leurs chefs, Godefroy de Bouillon. À sa mort, son frère Baudouin se fit couronner roi. Ce livre raconte comment il assura l'existence de son royaume, en fit une puissance régionale et établit sa prééminence sur les autres États nés de la croisade. L'auteur : Après une longue carrière scientifique, Lucien Leconte profite de sa retraite pour revenir à sa passion de toujours, l'histoire médiévale et en particulier celle de la Méditerranée orientale. | ||
| |||

| CASA RIVAROLA – UNE FAMILLE CORSE | |||
GHERARDI, E. | |||
 |
Eugène Gherardi, bastiais, Directeur du laboratoire de recherche LISA, en sciences humaines et sociales à l’Université de Corte, est l’auteur de nombreux ouvrages et travaux dans le domaine de l’histoire culturelle de la Corse. Il vient de publier chez Piazzola, publications de l'Université de Corse, l’histoire d’une famille, les Rivarola. Le tombeau des Rivarola, chapelle funéraire, est érigée sur la colline de Muzzelu, dominant Oletta et les hameaux des alentours. Les membres de cette famille corse appartiennent à la légende de l'île et certains d'entre eux ont connu des destins héroïques dans l'histoire mouvementée de l'Europe. | ||
| |||

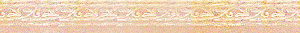
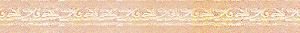
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |